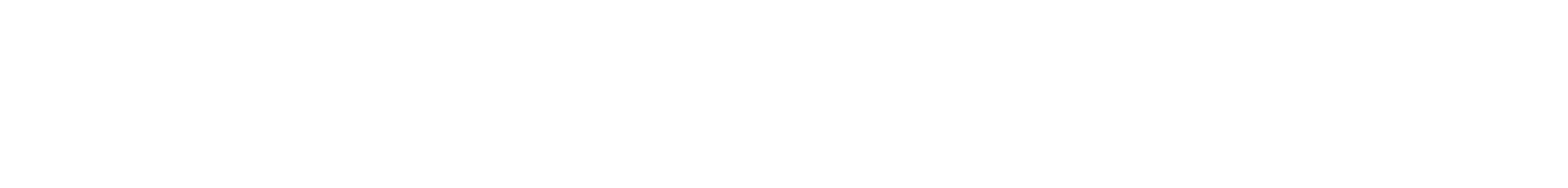Cohérence sclérosante
Nos organisations sont la résultante des interactions de nos expériences individuelles et collectives. La préservation de notre cohérence interne induit la lenteur du changement externe. Notre mode de pensée, notre système interne doit changer pour établir un système externe différent.

Dans mes derniers articles¹, j’évoquais le fait que les différents systèmes avec lesquels nous sommes en interaction ont été établis et sont maintenus et dirigés directement ou indirectement par la pensée de personnes humaines.
Une frontière, une entreprise, la monnaie et même le concept de temps sont des conventions entre êtres humains pour organiser notre vie collective.
C’est tout autant le cas des différentes idéologies et concepts tels que le néolibéralisme, la diversité et l’inclusion, la productivité ou l’intelligence artificielle.
Beaucoup de ces idées se sont développées et se sont sédimentées. Elles forment aujourd’hui ce que nous nommons cultures, normes sociales, lois, etc. Elles sont bien souvent devenues des évidences invisibles, des cohérences sclérosantes.
Par exemple
- Un enfant ne travaille pas en France aujourd’hui, c’était différent pour nos arrière-grands-parents. La loi a changé.
- L’homosexualité était considérée il y a peu de temps encore comme un délit² ou une maladie psychiatrique³,
- Rouler à droite est évident pour un Français, pas pour un Anglais.
- Pour mes enfants, un téléviseur est forcément en couleur et muni d’une télécommande.
Au-delà des forces d’inerties ou de pouvoir, qui sont aussi des constructions de la pensée humaine, nos institutions et nos organisations sont aujourd’hui la résultante dynamique des interactions de nos expériences individuelles et collectives et de notre contexte global.
Notre pensée influence le système. Le système influence notre pensée. Le tout maintient une forme d’équilibre. Jusqu’à un certain point, le système s’autoentretient au point parfois de se fossiliser, de se scléroser.
Préserver la cohérence, quoi qu’il en coûte
Pour nous sentir en cohérence, nous maintenons une forme d’ajustement optimisé. Si je suis trop en décalage, cela provoque une forme d’anomalie, parfois de souffrance. Cet ajustement est souvent associé à ce que nous nommons notre zone de confort.
Pour moi, la préservation de notre cohérence interne induit la lenteur du changement externe.
En prenant des sujets comme la religion, la sexualité, le genre, la drogue, sujets habituellement clivants dans la société, on constate bien que le système législatif évolue. Il faut pour cela que la conception, des personnes constituant la société, à propos du sujet, se transforme. Cette évolution est souvent très lente.
Dans des cas extrêmes, comme celui des talibans, on voit que la pensée de certaines personnes peut être imposée à tous, et surtout à toutes. L’évolution n’est pas toujours générative à notre échelle temporelle.
En dehors de ces cas extrêmes, et dans les contextes des organisations, publiques ou privées, la structure en place reflète en général assez bien l’équilibre entre les systèmes internes (personne, pensée) et externes (structure, loi, processus, etc.).
Les systèmes externes qui m’intéressent ici (organisations, lois) sont en grande majorité figés, comme fossilisés. Ils n’ont pas de capacité propre d’autotransformation. Ils ont été élaborés pour maintenir leur cohérence, à l’image du besoin de ceux qui les ont progressivement configurés.
Je fais donc l’hypothèse que pour changer une organisation en profondeur, il faut changer notre mode de pensée. Le système interne doit changer pour établir un système externe différent. Une chance c’est une capacité présente chez l’humain.
Dans le cas d’une volonté de transformation dans une entreprise, sans changement du système de pensée des personnes présentes, on prendra des techniques venues d’ailleurs, mais on les interprétera à partir du système de pensée existant.
Cela se termine le plus souvent par la mise en place de pratiques complètement dénaturées par rapport à l’intention initiale de la pratique.
J’ai été souvent témoin de cela lorsque j’ai contribué à intégrer des approches agiles en entreprise. Un exemple marquant est la transformation du meeting quotidien de synchronisation entre coéquipiers qui devient un meeting d’avancement détaillé au manager « command and control ».
Ce n’est pas la pratique qui fait la différence, c’est l’interprétation et la mise œuvre. C’est le mode de pensée et d’action des personnes concernées.

Lorsque la cohérence nous mène à l’absurdité…
… Et souvent à « l’insu de mon plein gré ».
Face au changement, un système à l’équilibre essaie de se maintenir, de maintenir sa cohérence et son intégrité existante.
Si je regarde seulement le changement climatique et le CO2, l’inaction que l’on peut observer apparaît absurde. Encore plus absurde lorsque je regarde l’ensemble des atteintes aux 9 « limites planétaires ».
Si je regarde les lois en place, les enjeux politiques, économiques, technologiques et sociaux en actions. Cela devient tout à fait compréhensible.
Je comprends ce qui se passe pour TFTP ou devrais-je dire « La page dont il ne faut pas prononcer le nom ! »⁴ et sa situation kafkaïenne.
Je comprends pourquoi on continue à nous parler de la croissance économique comme une évidence, oubliant que l’essentiel est peut-être ailleurs. Ne pourrions-nous pas nous contenter de vivre en relativement bonne santé, dans un confort minimal suffisant, en limitant les injustices ?
Mais pour être honnête, à titre personnel, ce chemin est effrayant. Mon système interne cherche à préserver son équilibre, son confort, ses croyances. Sauter aveuglement d’une cohérence connue vers une cohérence totalement inconnue est terrifiant, au moins autant que la souffrance endurée aujourd’hui. Un tien vaut mieux que deux tu l’auras⁵.
Comme je le dis souvent : je contribue à ce que je dénonce.
Sans compter que changer le système de pensée, ce n’est pas seulement changer les pensées. C’est aussi changer notre comportement puisque notre intention, notre perception, notre interprétation et notre action sont interdépendantes.
Sortir de la cohérence sclérosante, est-ce même possible ?
Tout ça pour en arriver à partager avec vous cette croyance que j’observe se renforcer en moi.
Rien ne changera tant que :
- Nous ne porterons pas une attention particulière, individuellement et collectivement, à la qualité de nos pensées.
- Nous ne chercherons pas à rendre explicites les qualités qui permettront de favoriser le développement de capacités génératives.
- Nous ne pratiquerons pas dès le plus jeune âge la conscience de soi et des autres, la réflexivité, l’écoute, la contribution au bien commun.
- Etc.
Cela implique donc d’explorer nos systèmes de pensées, notre système interne, celui qui élabore les systèmes externes.
À l’échelle d’une organisation qui souhaite effectuer une transformation, cela implique donc d’investir sur le long terme, le temps nécessaire à cet exercice d’explicitation des valeurs, croyances ou principes qui sont habituellement tacites et implicites.
Mon premier problème est souvent de faire « sauter le verrou » très présent dans le système actuel qui consiste à penser que cet exercice n’est pas pertinent. Ce n’est pas du vrai travail. Penser et explorer sa pensée n’est, non seulement, pas une action, mais c’est une perte de temps.
Encore une fois, tout est question de perspective et d’interprétation.
Pour résumer
- Les systèmes externes (structures) sont créés par nos systèmes internes (pensée). Le second cherchant à maintenir sa cohérence a créé les premiers pour qu’ils soient résistants aux anomalies perturbatrices.
- Les mécanismes de régulations vont absorber et dénaturer les pratiques issues d’autres modèles de pensées, pour maintenir ou rétablir l’équilibre initial.
- Pour transformer une organisation, il est nécessaire de transformer notre conception du monde. Cela nécessite d’en être curieux. C’est Se Regarder Voir.
À quel point souhaitez-vous comprendre pourquoi vous pensez ce que vous pensez ou faites ce que vous faites et chercher à en évaluer les conséquences ?
Références et sources
- Voir : Activiste de la qualité de conscience https://www.se-regarder-voir.com/activiste-de-la-qualite-de-conscience/ - Virtuoses en réalités subjectives https://www.se-regarder-voir.com/virtuoses-en-realites-subjectives/ - Contribuer à une humanité florissante https://www.se-regarder-voir.com/contribuer-a-une-humanite-florissante/ - Générations de pensées https://www.se-regarder-voir.com/generations-de-pensees/
- Histoire LGBT en France https://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_LGBT_en_France
- 1970 : quand l’homosexualité était un symptôme psychiatrique https://www.ina.fr/ina-eclaire-actu/1970-quand-l-homosexualite-etait-un-symptome-psychiatrique
- Lettre aux associés de TFTP : https://time-for-the-planet.docs-view.com/v/ed2d79ad68_4381c4c377912918df1722fbcc3695615c3f0034 et post LinkedIn correspondant : https://www.linkedin.com/posts/tftp_on-change-de-nom-chers-associés-activity-7046742799303512064-OuO7?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
- https://fr.wiktionary.org/wiki/un_tien_vaut_mieux_que_deux_tu_l’auras